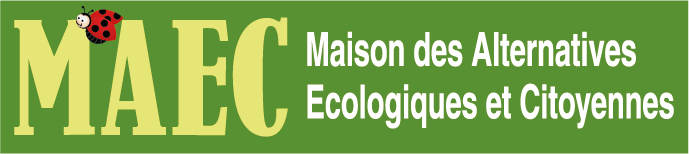Entre le 19ᵉ siècle et aujourd’hui, le ciel nocturne a, par endroit, perdu ses étoiles. En cause : la lumière artificielle des villes, dont les conséquences sur la biodiversité et la santé humaine sont souvent reléguées au second plan.
D’où vient la pollution lumineuse
La première tentative d’éclairage public en France remonte au 16e siècle, à Paris. Son objectif premier était de concourir à la sécurité des citadins en diminuant le risque de vols et d’attaques à mains armées. Le terme de « pollution lumineuse » a été médiatisé dans les années 1970, avec la massification de l’éclairage fonctionnaliste suite à l’étalement urbain des années 1950-1960. Selon le géographe Samuel Challéat, les astronomes ont été les premiers « lanceurs d’alerte » : « les astronomes vont voir se rapprocher de leurs observatoires le front d’urbanisation et, avec lui, la quantité de lumière qui va finalement venir les acculer et perturber leur observation astronomique du ciel ».
C’est alors que l’idée d’excès d’éclairage va apparaître : la question est moins celle de l’éclairage public en soi que de son expansion accélérée.
Un impact sur la biodiversité et la santé humaine
Outre notre rapport esthétique au ciel étoilé, l’éclairage de nuit pose des problèmes écologiques et sanitaires. Concernant la biodiversité, il modifie les cycles de sommeil de certaines espèces, facilite la chasse pour les prédateurs et perturbe le mouvement des oiseaux migrateurs. Par ailleurs, l’activité des insectes pollinisateurs se trouve réduite de 62% en zone éclairée ; en conséquence, la flore n’est pas épargnée.
La pollution lumineuse a aussi des répercussions sur la santé physique et mentale des humains : les cycles de sommeil sont également altérés du fait d’une perturbation de l’horloge biologique interne et de retards à l’endormissement. Les risques d’obésité se trouvent aussi accrus.
Les mesures pour limiter la pollution lumineuse des villes
Le combat contre la pollution lumineuse est inscrit dans la loi française depuis 2013. De nombreuses villes, à l’instar de Strasbourg, ont déjà pris des mesures pour atténuer ses effets, avec une réduction des surfaces éclairées, des durées d’éclairage (en instaurant des coupures au milieu de la nuit), et une utilisation de technologies mieux adaptées aux besoins.
Pour Anne-Marie Ducroux, présidente de l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN), nous avons trop été habitués à une « ébriété lumineuse » : « on ne choisissait la quantité et la qualité d’éclairage que par une prescription de l’offre et non pas par une analyse des besoins ».
Les choses évoluent, mais lentement. En attendant, il est encore possible de rallumer les étoiles en s’éloignant des zones lumineuses. La France dispose de sept réserves internationales de ciel étoilé (les RICE) : le pic du Midi, le parc des Cévennes, le parc du Morvan, parc des Landes de Gascogne, le parc du Mercantour, le parc de Millevaches et le parc du Vercors.
Retrouvez l’émission de France Culture La pollution lumineuse et ses impacts sur l’environnement | France Culture